
Jamais plus je ne me rendrais au foyer familial, je peux dire adieu au pavillon de ma jeunesse. À présent, j’ai compris, il est temps de coupon le cordon. Fini, le temps où je pouvais me vautrer dans les ultimes de mon adolescence, ce temps s’est enfui.
Oh, je ne m’en vais pas de gaité de cœur : là-bas, on mange gratis.
De toute façon, la transition est aisée : il y a longtemps que je dors sous d’autres toits que celui de mes parents, mais à présent le logis familial me fait douloureusement sentir que ce n’est plus la peine d’y mettre les pieds.
Je ne parle pas du babillage épuisant de ma mère ou des borborygmes de mon père me reprochant de confondre la maison avec un hôtel doublé d’une laverie, derniers fragments d’une jeunesse enfuie (c’est merveilleux, les vêtements arrivent froissés et sales dans la valise et à la fin du week-end, ils réintègrent la-dite valise, propres et pliés. Quand je vous dis que ce pavillon a des pouvoirs magiques) – ça, j’ai l’habitude.
Mais ce foyer, ces murs et ces fenêtres, ils murmurent et conspirent à ma perte, ils me persécutent personnellement, conjurent les éléments pour me pourrir la vie.
Elle a dû entendre que je regagnais les pénates familiales dans le but de trouver le repos, donc elle détruit méthodiquement mon sommeil au scalpel rouillé, tétanos offert par la maison.
Les effluves de rap qui se déversent des fenêtres ouvertes d’un kéké à minuit, et même le chat qui hurle à la mort à partir de 7 heures du matin, c’est pour les petits joueurs, c’est anecdotique – quoique la technique du chat comporte un certain sadisme : la seule façon d’avoir la paix, c’est de le laisser troubler mon sommeil à force de ronronnements et de tentatives de se blottir contre sa maîtresse de façon à entraver mes mouvements et me gêner, voire le combo : se pelotonner contre mon oreille pour ronronner à pleines turbines.
Plus original : m’acculer au sacrifice.
Je vous brosse le portrait : le poseur de vitres arpente les arcanes de la maison pour a quatrième fois (au bas mot), suite à des oublis en chaîne, des erreurs de dimension, … Je vous le donne pour mille : l’homme s’est encore égaré.
Il propose donc benoîtement d’achever son travail le lendemain aux aurores, à huit heures.
Comprendre, il veut me faire mourir de fatigue et de neurasthénie.
De guerre lasse, je consens mais j’entends les radiateurs ricaner devant cette perspective de nuit tailladée. (bien sûr, ils ne pouvaient pas prévoir que je me ferai livrer les croissants au petit déjeuner)
Mais ce n’est pas tout – ce serait trop beau.
Le boss final : le réveil à 2h25.
Première attaque : le coup de fil. C’est un échec critique, je n’entends pas la sonnerie qui m’exhorte à porter assistance à ma très honorable voisine, qui a (encore) chu. Qu’à cela ne tienne, le logis honni sort de sa pokéball son attaque spéciale : les pompiers qui viennent sonner à la porte. Et ça ; c’est très très méchant.
Je ne peux plus reculer : non seulement je dois me lever, mais de surcroit je dois de ce pas me mouvoir jusqu'à l'étage inférieur tel le zombie afin de fouiller parmi les 50 clefs que mes parents conservent comme des reliques (dont 45 correspondent à d’anciennes serrures), constituées en trousseaux plus ou moins éclopés (parfois constitués d’un ensemble de clefs identiques, très « diamants sur canapé ») sans étiquette.
Le bouquet final : l’ultime coup de sonnette pour rendre les clefs.
Les pompiers sont des gens biens : lorsqu’on leur parle de boîte aux lettres, ils ne veulent pas y mettre autre chose.
Il y a également les doux dingues. Je vous refais la scène. Je m’équipe tel l’Inuit pour traverser le jardin afin d’aller nourrir les locataires de la cabane à outils.
La femelle m’accueille, comme d’habitude, plantée sur le seuil, me fixant l’air de dire « alors là, même pas tu t’approches de mes bébés. ». Coupe le cordon, ils ont quatre mois tes gosses. Sentant certainement l’odeur du chat du bercail, elle se frotte consciencieusement contre mes jambes, afin de coller plein de poils noirs sur mon pantalon blanc (c’est malin, maintenant je ne peux plus me fondre dans la neige).
Soudain un charivari tinte à mes oreilles : ce n’est qu’un chaton qui se sentait vulnérable et qui a voulu changer de cachette (d’habitude les chatons sont absolument invisibles). Mais courir sur une étagère en bois, ça fait du bruit et ça renverse des objets.
Il est planqué entre deux échelles, et c’est vrai qu’avec sa fourrure noire il aurait presque pu être invisible. Mais trop tard, vu la discrétion de son déplacement, je l’ai repéré et je ne compte pas le lâcher. Je m‘approche à petits pas, main tendue et ouverte, tandis qu’il roule des yeux fous et tente de rentrer dans le mur. Un pas de plus et il se sent acculé, il n’y tient plus, il bondit tel le cabri sur l’étagère et de sa foulée élastique détale à une vitesse que seul un jeune chat peut atteindre, boule de feu noir fendant la pelouse. Avant que je n’ai le temps de cligner des yeux, une seconde tâche aérodynamique poursuit la 1ère : c’est sa mère qui lui court après (pour le gronder ? Pour ne pas le perdre de vue, vous savez ma bonne dame avec les enfants on sait jamais ? Pour jouer à cache-cache ?).
Après avoir rempli les gamelles, je retourne à l’entrée de la maison, dans le jardin un arbre bruit, s’il n’avait pas été si touffu j’aurai pu repérer les deux matous.
Drôles de bêtes, c’est cette maison qui les rend timbrés pour me désorienter.


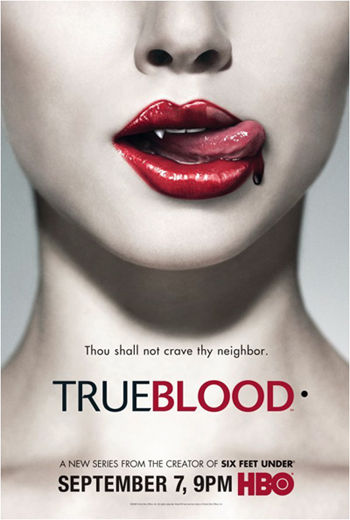

Ce que certaines chansons murmures, au creux de la nuit, quand les paupières s'abaissent.
On aimerait toujours pouvoir hurler cette phrase, cette dernière phrase, et la voir se réaliser. Parce que la solitude est trop inquiétante, dans une vie structurée par la présence d'autrui. Miroir et solitude.
Se débarrasse-t-on jamais des fantômes, vieux amours ?
"Je voudrais que mon amour meure
Qu'il pleuve sur le cimetière
Et les ruelles où je vais
Pleurant celle qui crut m'aimer."