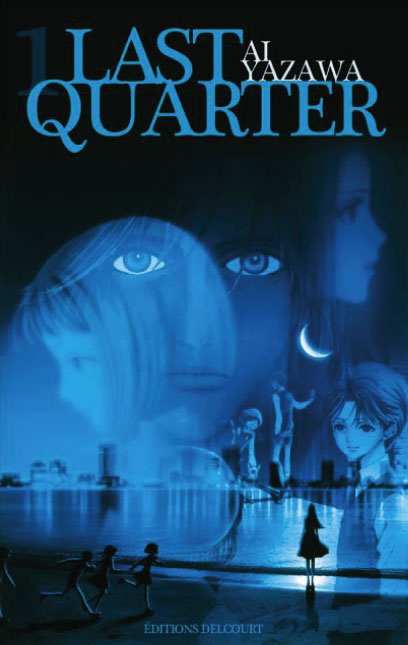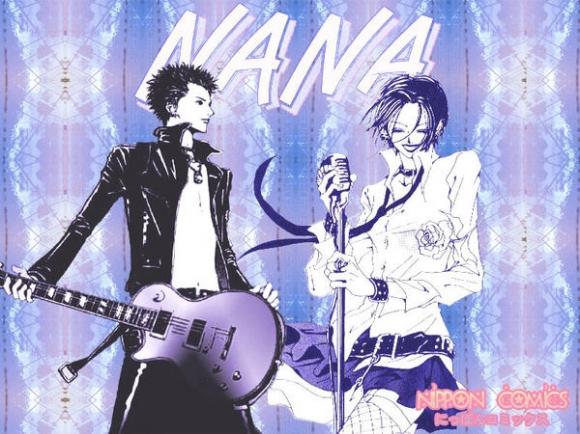Hey, Machi !
Comment vas-tu ?
Que veux-tu que je te dise ? Moi, contre toute attente, je vais bien. Aujourd'hui. À l'instant où je t'écris.
De toute façon, ça sert à rien de déprimer trop longtemps.
Je sais ce que tu vas te dire, Machi.
Pourquoi devrais-je déprimer ?
Disons qu'à force de l'écarteler, même la plus résistante des étoffes se déchire. Même un cœur peut se déchirer. Même si c'est de notre propre faute.
Mais ce n'est pas grave, Machi. Rien n'est grave.
Je suis responsable. Alors...
Je prends des vacances, Machi.
Je sais ce que tu te dis : comment prendre des vacances lorsqu'on ne travaille pas ?
Je m'évade, Machi, je prends la clef des champs, et Dieu que ça fait du bien de respirer de l'air frais.
J'ai fendu un cocon trop étroit et je me sens seule et libre et jeune et... vulnérable. Redevable envers le carcan de soie, étendu, abandonné.... seul à son tour, au bord de la route. De ma route.
Mais que veux-tu, Machi ? Il faut bien que la chenille devienne papillon.
Bien que je sois loin d'être adulte. Bien que je sois loin d'être entière.
Ah, Machi, je suis bien, si tu savais.
On s'est enfuies, avec Fée.
C'est bientôt « les fêtes », ici.
Alors, avec Fée, on s'offre plus qu'un objet sans valeur : on s'offre un souvenir. Une échappée du réel.
On loue une « villa », comme ils disent dans les agences de voyages, une villa, tu parles, une petite maison miteuse, une vieille bicoque pour vacanciers ruinés, oui.
Mais elle est géniale. Parce que c'est la notre.
On nous la loue... oh, une misère.
Il faut dire que le bord de la mer en décembre, c'est pas forcément le moment de l'année qui déchaîne les foules.
Surtout cette mer.
Comme elle est belle lorsqu'elle houle et qu'elle hurle et qu'elle se soulève...
Fée et moi passerons des heures à la contempler par la fenêtre.
Pourquoi passerons ?
Oh, elle ne m'a pas encore rejointe.
Pourquoi ?
Une sorte d'accord tacite.
J'imagine qu'elle a encore quelques affaires à régler, avant de prendre le large.
Il faut dire que c'était si soudain...
Je veux dire, depuis le temps qu'on la projette, cette escapade...
Mais une seule condition : pas de date précise. Pas de réservations.
On attend un signe.
On l'a eu. Plus d'attache.
Il était temps de prendre le large.
J'avais besoin de briser mes chaînes, vous comprenez ?
Les autres.
J'ai pris le premier train venu, direction nulle part.
Elle pourra bien m'y rejoindre. Me rejoindre.
Poussée la porte d'une agence immobilière à moitié morte, hors saison oblige.
Formalités. Que de tracas.
Je crois qu'elle a senti que j'avais besoin d'être seule.
La mer me rend rêveuse. Elle me rappelle ta petite île, Machi. La notre ?
Un ersatz de retour aux sources, j'imagine. Réminiscence.
Dieu que c'est bon.
Le paysage est magnifique. Exactement comme j'aime.
Contre toute attente, on m'a offert de vivre, l'espace de quelques nuits, de quelques songes, là où j'ai toujours voulu être.
Toucher du doigt cet Eldorado que j'ai si souvent vu dans mes chimères.
La maison est un peu ancienne. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire.
La maison est moderne, un petit bungalow typique qui se raccroche aux falaises.
Meublée sommairement.
Mais ça m'est égal. Car la réalité n'a plus de consistance, et mes illusions plus de barrières.
La « villa » devient telle que je l'ai toujours imaginé, et je sais que Fée verra comme moi.
Laisse-moi te faire visiter.
Nous sommes seules, elle et moi, comme abandonnées au milieu d'une grande vallée qui surplombe la plage.
La maison est ancienne, froide et un peu humide.
Elle sent le passé. Celui d'autres. Et rien que ça, ça fait du bien.
De ne plus se sentir tout à fait soi à chaque inspiration.
Elle est meublée à l'ancienne.
Tout est en bois sombre.
Un buffet garde férocement un service de vaisselle à l'ancienne et poussiéreux.
J'aime passer des heures dans la cuisine à laver, essuyer, polir chaque assiette encore et encore. Je ne m'en lasse pas.
La salle d'eau n'est pas très moderne, sans être vétuste. Cependant, rien qui ne mérite qu'on s'y attarde.
Il y a deux chambres
Une chambre d'enfant, dans les tons jaune pâle, un petit lit exigu coincé entre deux murs, un vieux berceau en fer forgé, la peinture s'écaille. Elle sent le renfermé, et des taches d'humidité s'attaquent au plafond. Je n'aime pas beaucoup cette pièce, j'ai l'impression d'être dans une chambre funèbre. J'ignore pourquoi.
Parfois, il m'arrive d'y fumer, pour exorciser les fantômes qui y rodent, en ouvrant grand la fenêtre, debout contre le vent, gelée, transie. Très vite, la cigarette s'éteint, alors je ferme volets et fenêtre et je m'enfuis bien vite, claquant la porte derrière mon dos.
L'autre chambre est majestueuse.
Un lit à baldaquins y règne, il occupe presque tout l'espace, drapés de lourdes tentures en velours rouge encore doux malgré les ans, elles contrastent avec le vert du papier peint.
La fenêtre donne sur de vastes plaines herbeuses couchées par le vent.
Un vaste « dressing » occupe tout un mur, avec plus de place qu'il n'en faudrait pour ranger une garde-robe royale.
Les panneaux coulissants en bois clair, montés sur rails, offrent une touche de modernité surprenante à l'ensemble.
Mais ma pièce préférée reste la salle à manger.
Je ne sors d'ici qu'en cas de nécessité absolue, pour cause de tempête, tu comprends.
Alors, il faut bien que je passe mon temps quelque part.
Il n'y a pas de télévision, ici, c'est tout juste si l'électricité y est installée, en fait.
Ça ne me manque pas. Au contraire : ça gâcherait tout.
Je m'installe sur une de ces chaises standardisées en métal et pseudo cuir, à la fois simples et laides, modernes et indémodables, totalement incongrues et je m'assoie derrière cette table sans âge du même bois que le buffet (il est à côté) et je fume quelques cigarettes, je bois des litres de thé refroidis, je lis, je couvre des pages de mon écriture confuse et empressée et surtout, surtout, je me noie dans le décor.
Le salon dispose de la meilleure vue.
Un seul coup d'œil et on est happé : par la mer, belle et terrible, la pluie, le vent, et parfois les éclairs qui fendent l'air, c'est beau Machi, c'est beau, c'est inquiétant, c'est sombre et c'est fascinant.
Cette vieille bicoque craque, gémit, j'aime cette sonorité, la seule qui m'atteigne ici, avec celle des hurlements du vent et les cris des vagues qui se brisent contre les rochers et les falaises qui surplombes l'immensité liquide, c'est apaisant. Je me sens en sécurité.
Dehors, il fait froid, il pleut et moi je suis à l'abri, dedans.
Je crispe mes doigts sur une tasse brûlante.
Il fait bon, ici. C'est chaud... c'est confortable... on est bien... On s'abandonne.
Pour l'instant, je pousse le chauffage, un peu trop peut-être, mais je m'y sens bien. Douce langueur.
Lorsque Fée sera là, nous ferons du feu.
Ce que j'aime regarder la pluie strier les vitres en tirant sur mon filtre et en saturant l'air de nicotine.
J'aère peu : je déteste lutter pour clore les battants de la fenêtre.
Lorsque le temps s'y prête (Comprendre : lorsque j'estime que le vent est trop « faible » pour déraciner un arbre. Tu comprends, ici l'hiver, c'est tout le temps la tempête. Quel bonheur.), je sors par la porte de derrière, et je sors prendre l'air, faire une promenade, des courses...
Enfermée dans un vieil imperméable trop grand et des bottes de pluie dans lesquelles je nage, je fonce tête baissée sous les gouttes, s'efforçant de maintenir la capuche rivée sur ma tête.
Je m'enfonce dans la boue dans laquelle baignent de grandes herbes sauvages qui m'enserrèrent jusqu'aux chevilles.
L'air diffuse un parfum d'herbe fraîchement coupée et de terre humide et de nature et de liberté, et de liberté, et je me sens tellement bien, la plaine ne semble ne plus avoir de fin, j'ignore sur je marche dans la bonne direction et parfois je me perds, je ne vois pas le bout de cette vallée qui débouche sur un pauvre village de trois maisons, une église et deux échoppes encore ouvertes (les autres attendent le retour de l'été), mais je finis toujours par atteindre mon but, j'ignore si la promenade a duré dix minutes ou dix heures, et je rentre, fière. Heureuse.
Et lorsque Fée sera là, tout sera parfait.
J'ignore même si nous rentrerons.